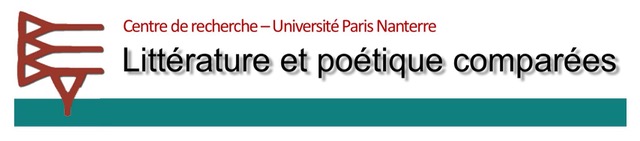|
Abécédaire des comparatistes de Paris Ouest Nanterre
T comme
Théorie littéraire.
Voir
Antiquité,
Archéologie du littéraire,
Ecriture de soi,
Poésie,
Mythe,
Philosophie,
Psychanalyse,
Russes,
Tragédie,
Traduction,
Weltliteratur.
Traduction.
Même si les comparatistes, quand ils font de la recherche,
s’attachent à étudier les textes originaux, le recours aux traductions
est un aspect essentiel de leur travail : non seulement parce qu’elles
sont indispensables à l’enseignement (les étudiants ne pouvant
connaître toutes les langues, elles permettent de bâtir des programmes
variés) mais aussi parce que les publications de littérature comparée
comportent toujours une traduction française des textes cités. C’est
ce qui conduit les comparatistes à devenir souvent eux-mêmes
traducteurs ou à diriger des collections qui publient des traductions.
Les comparatistes de Nanterre ont particulièrement illustré cette
tradition : on doit à Pierre Rivas et Michel Riaudel de nombreuses
traductions du portugais, à Abdelwahab Meddeb, plusieurs traductions
de l’arabe, à Jean-Claude Laborie la traduction (avec Anne Lima) d’une
anthologie des Jésuites du Brésil (La mission jésuite du Brésil, 1549-
1570, éd. Chandeigne, 1998), à Anna Jacovidès-Andrieu une anthologie
de la poésie chypriote, à Karen Haddad (en collaboration avec Philippe
Brunet) une anthologie de cent traductions françaises différentes du
plus célèbre poème de Sappho (L’égal des dieux, éd. Allia, 1998), à
Olivier Kachler une traduction de Douze de Blok (éd. Allia, 2007), à
Jean-Yves Masson des traductions de poésie allemande, anglaise et
italienne, ainsi qu’une Anthologie de la poésie irlandaise du XXe
siècle (éd. Verdier, 1996). Jean-Yves Masson et Colette Astier (sous
le nom de Gabrielle Althen) ont également traduit et présenté les
Poèmes à la nuit de Rainer Maria Rilke (éd. Verdier, 1994). Jean-Paul
Manganaro, membre associé du centre Littérature et Poétique Comparée,
est l’auteur de très nombreuses traductions de l’italien (dont une
dizaine en collaboration avec Camille Dumoulié). Les problématiques de
la traduction sont également au cœur du colloque organisé par Camille
Dumoulié et Michel Riaudel sur Le corps et ses traductions (éd.
Desjonquères, 2008). Enfin, c’est en 2002-2003 que se sont tenues à
Nanterre les premières réunions organisées par Jean-Yves Masson pour
élaborer, en collaboration avec Yves Chevrel, l’Histoire des
traductions en langue française publiée depuis 2012 aux éditions
Verdier, à laquelle participent plusieurs membres ou anciens membres
du centre de recherche comparatiste de Nanterre, notamment Claude de
Grève.
Tragédie.
Lieu de toutes les rencontres, de tous les malentendus, de
tous les délires. Lieu éminemment comparatiste, donc. Il y eut d’abord
la tragédie grecque, dont on sait finalement fort peu de choses. Puis
Platon et Aristote. Puis les tragédies de Sénèque. Puis un grand vide
(sauf à Byzance). Puis les néotragédies de la Renaissance et des
siècles dits classiques. Puis la philosophie allemande : Schiller,
Schelling, Schlegel, Hegel, Solger, Nietzsche, Benjamin. Puis la
philologie germanique : Müller, Bernays, Wilamowitz. Puis Wagner. Puis
Artaud. La tragédie est partout et nulle part, souvent confondue avec
son double conceptuel moderne, le tragique, qui a tendance à tout
recouvrir de son ombre fatale. Elle occupe en tout cas une place
privilégiée au Centre de recherches en Littérature et Poétique
comparées : Camille Dumoulié et William Marx ont enfourché ce cheval
de bataille dans leurs cours et séminaires comme dans plusieurs
livres, le premier notamment dans Nietzsche et Artaud : pour une
éthique de la cruauté (Presses universitaires de France, 1992), le
second dans Le Tombeau d’Œdipe : pour une tragédie sans tragique
(Éditions de Minuit, 2012). Et la chevauchée n’est pas près de
s’achever.
Tsiganes.
Gitans, Bohémiens, Rroms et Gens du voyage font partie des
peuples dont les cultures trouvent leur place à Nanterre. Soutenus par
la Mairie de Nanterre et un réseau d’associations, différents projets
ont été conçus par les comparatistes de notre Département. L’objet de
ces projets a été de confronter sans relâche l’image de ces
populations dans l’imaginaire collectif aux réalités de leurs modes de
vie et de leurs pratiques artistiques. Camille Dumoulié a ainsi
présenté en 2012 un cycle de projections de films et de débats
consacré à Carmen, figure paradoxale de l’Eros latin. En novembre
2012, Camille Dumoulié et Carole Boidin ont organisé un colloque
interdisciplinaire et une série d’événements culturels sur le campus
et dans la ville de Nanterre, sous le titre « Tsiganes, Roms, gens du
voyage citoyenneté, mobilité et territoires ».
|