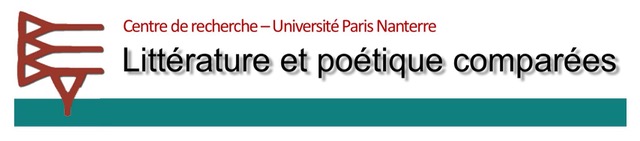R comme
Révolution.
La Révolution française n’est pas un événement historique
parmi d’autres : c’est aussi un mythe fondateur des temps modernes
dont la portée n’a pas fini d’être mesurée. Depuis plusieurs années
des cours sont données à Paris-Ouest – de la licence à l’UCP
(« université de la culture pour tous »), sur les métamorphoses
littéraires, théâtrales ou cinématographiques de la Révolution
française, de Georg Büchner à Pierre Michon, de Griffith à Eric
Rohmer. Récemment, une journée d’étude sur « l’imaginaire de la
Terreur » (organisée par F. Leichter-Flack et Philippe Zard) a fait
l’objet d’une publication dans la revue Raison publique
(n°16, octobre 2012). Camille Dumoulié, dans Fureurs. De la fureur
du sujet aux fureurs de l’histoire (Anthropos-Economica, 2012), a envisagé le désir
révolutionnaire dans une perspective psychanalytique, en lien avec la
fureur intime du sujet, et s’est interrogé sur la possibilité de
définir la Terreur comme une politique du sublime.
Rousseau et le romantisme.
Les comparatistes ne s’intéressent pas
seulement à l’écrivain, mais également au philosophe, au compositeur,
au musicographe ayant posé les fondements d’une nouvelle sensibilité
et d’une nouvelle hiérarchie des arts, susceptible de transformer
bientôt la musique comme modèle de tous les arts – ce qu’elle fut de
fait au XIXe siècle. L’ouvrage d’Emmanuel Reibel Comment la musique
est devenue « romantique », de Rousseau à Berlioz (Fayard, 2013)
s’intéresse à l’aventure d’un mot, parti de la sphère des paysages et
de la littérature chevaleresque pour investir progressivement – de
l’œil à l’ouïe – des objets musicaux. Un colloque international
intitulé Le Dictionnaire de musique de Rousseau et sa descendance
européenne (2012) a montré comment bien au-delà du projet
lexicographique, l’ouvrage de Rousseau constituait une somme
esthétique, posant les fondements d’une nouvelle théorie des arts. Une
autre journée d’étude (2014) s’est intéressée aux commentaires de ce
Dictionnaire dans les volumes « Musique » de
l’Encyclopédie méthodique, excellent prisme permettant
de mesurer l’évolution du goût à l’aube du romantisme.
En partenariat avec le CSLF, Emmanuel Reibel
et Guillaume Bordry ont enfin rédigé l’ensemble des entrées
« Musique » du Dictionnaire du romantisme dirigé par Alain Vaillant
(CNRS, 2012).
Russes.
Hasard ou héritage historique, le chemin de la Russie passe
toujours à l’Ouest de Paris. De Gogol (Claude De Grève) à Platonov
(Frédérique Leichter-Flack), en passant par Dostoïevski et Tolstoï
(Karen Haddad) ou Blok (Olivier Kachler), les Russes ont fait l’objet,
chez les comparatistes de Nanterre, de nombreux articles, livres,
séminaires et colloques. Si ces travaux portent essentiellement sur le
roman, autour de l’axe Poétique du récit, les « inventions
d’inconnu des Russes », titre d’un colloque organisé par Karen Haddad
en 2007 sur les poètes symbolistes de l’« Age d’Argent » ont également
été explorées. Mais les Russes sont aussi parmi nous à travers la
réflexion critique : théorie de la traduction, littérarité,
dialogisme, estrangement.. autant d’outils familiers aux
comparatistes. Enfin, un accord avec l’Université Lomonossov de Moscou
a donné forme à ces échanges, et suscité lui aussi un colloque
organisé en 2009 par Liliane Picciola et Karen Haddad (« France-
Russie, Itinéraires croisés des représentations »). Voir aussi
Dissidence,
Dostoïevski,
Poésie,
Révolution,
Théorie littéraire,
Traduction.