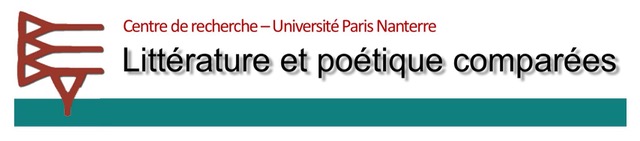|
Abécédaire des comparatistes de Paris Ouest Nanterre
P comme
Périphérie.
Construite « au-delà du périphérique », Nanterre est
historiquement le lieu d’une réflexion sur les marges et leur rapport
au centre. Les comparatistes, tant par leurs méthodes que par leurs
domaines de recherche, n’y font pas exception à la règle. Rapports
Orient/Occident, mondialisation, transferts culturels, identités et
genres… autant de directions explorées dans leurs ouvrages, colloques,
séminaires et cours. J.-M. Moura, membre du CSLF, qui a publié divers
ouvrages sur la littérature de voyage et l’exotisme, et qui participe
à l’axe « Espaces littéraires transculturels », travaille quant à lui
dans le champ des post-colonial studies
(Littératures francophones et théorie postcoloniale, P.U.F., 2013).
Si les notions de « centre » et de « périphérie » sont elles-mêmes historiques
et soumises à constante réévaluation, certaines littératures, peu étudiées
dans le champ comparatiste français, font l’objet de thèses originales :
littératures lusophones du Brésil, mais aussi du Mozambique, comme
dans la thèse en cours de Fernanda Vilar, ou turque, comme dans celle
d’Elise Duclos sur Pamuk et l’intertextualité européenne, ou encore du
Pacifique. Voir aussi Brésil,
Occident,
Orient,
Russes,
Tsiganes,
Weltliteratur.
Philosophie.
Depuis Platon, pour qui le différend qui oppose poète et
philosophe est aussi ancien que fondamental, jusqu’à la naissance de
l’idée de Littérature, dans son sens moderne (voir « Littérature »),
philosophie et littérature ont un destin conjoint. Paradoxalement,
alors que Kant et Hegel annonçaient la fin de l’art et des Belles
Lettres, c’est la philosophie qui est parvenue à un terme historique
et la littérature qui a constitué sa relève. Au point qu’au XXe siècle
l’une et l’autre, selon le vœu de Victor Hugo, se trouvèrent
« mêlées » et que les philosophes ont emprunté aux écrivains nombre de
leurs concepts. La littérature générale et comparée, comme méthode et
comme discipline, s’inscrit dans cette époque moderne de la
Littérature. Elle est autant le fruit de ce mutuel engendrement que de
cet éternel conflit. Dès lors, il lui appartient de penser dans
l’entre-deux des discours et des théories, sinon d’être une pensée de
l’entre-deux. Elle étudie les liens qui unissent l’éthique et
l’esthétique, l’idée et l’image, la fiction et la vérité, le concept
et le percept. A quoi et comment pense la littérature ? En quoi cette
dernière a-t-elle repris à la philosophie la question des fins ? Tels
sont les enjeux comparatistes d’une interrogation, aujourd’hui, sur
les liens qui unissent la littérature et la philosophie. Ils se
retrouvent dans le livre de Camille Dumoulié, Littérature et
philosophie. Le gai savoir de la littérature (A. Colin, 2002), dans
celui de William Marx,
L’Adieu à la littérature : histoire d’une dévalorisation
(xviiie-xxe siècle) (Éditions de Minuit, 2005), ou dans
celui de Frédérique Leichter-Flack, Le Laboratoire des cas de
conscience, 2012). Mais ils font aussi l’objet d’une recherche
collective dont témoignent le recueil La fabrique du sujet. Histoire
et poétique d’un concept (Editions Desjonquères, 2011), Littérature et
philosophie de Philippe Zard et Anne Tomiche (Artois Presses
Université, 2002) et des sujets de thèse parmi lesquels David Herbert
Lawrence et Georges Bataille, l’érotisme et le sacré, par Juliette
Feyel et Le nomadisme. Histoire d’une représentation entre littérature
et philosophie, par Emile Rat.
Poésie.
Plus c’est difficile à traduire, mieux la différence des
langues et des cultures se laisse appréhender : la poésie est la
pierre de touche du comparatisme. Historiquement incarnée au Centre de
recherches en Littérature et Poétique comparées par les deux figures
de poètes professeurs Colette Astier (poète sous le nom de Gabrielle
Althen), qui a dirigé notamment le volume Poésie et Mystique
(Littérales, n° 23, 1998), et Jean-Yves Masson, auteur, entre autres
travaux, de Hofmannsthal, renoncement et métamorphose (Verdier, 2006),
la poésie a fait l’objet plus récemment de séminaires organisés
notamment par William Marx (sur le postsymbolisme et le modernisme)
ainsi que d’une thèse de Florian Mahot Boudias sur la poésie politique
dans l’entre-deux-guerres (autour d’Aragon, Auden et Brecht). Un autre
doctorant, Mathieu Perrot, prépare une thèse sur la tentation
anthropologique dans la poésie française et américaine du surréalisme
à la Beat Generation. Plusieurs thèses soutenues récemment, comme
celle de Joanna Rajkumar (Les limites du langage d’un siècle à
l’autre, sur Baudelaire, Hofmannsthal et Michaux), ou celle d’Ilena
Antici, qui comparait Proust à Montale et Salinas, se situaient
également dans cette tradition, alliant poésie comparée et réflexion
sur la traduction. Un colloque international sur le poète Claude Vigée
a par ailleurs été organisé à Paris Ouest en 2010 (Là où chante la
lumière obscure… Hommage à Claude Vigée, Sylvie Parizet dir., éd. du
Cerf, 2011), poète qui avait déjà publié en 2006 un recueil d’ essais
et d’entretiens en collaboration avec Sylvie Parizet (Les Portes
éclairées de la nuit, éd. du Cerf). Voir aussi Russes,
Traduction.
Proust.
Celui qui voyait en L’Idiot de Dostoïevski « le plus beau
roman » qu’il connaissait fut sans doute, par les écrivains de son
temps, l’un des plus passionnés par la littérature étrangère, qu’il
lisait en traduction. Proust fasciné par la littérature étrangère,
Proust vu de l’étranger, comme un étranger, c’est cette triple
perspective qui a justifié un programme de recherche comparatiste qui
s’est développé pendant plusieurs années à Nanterre et dans d’autres
Universités européennes. Avec Vincent Ferré (Paris 13, puis Paris 12),
Karen Haddad a organisé, entre 2007 et 2013, une série de journées
d’étude et un colloque (actes publiés dans Proust, l’étranger, CRIN,
2010, et « Proust, dialogues critiques »,
http://www.fabula.org/colloques/index.php?id=2156). Le centenaire de
Du côté de chez Swann, quant à lui, a été célébré d’abord aux Pays-Bas
avant de l’être à Nanterre, dans le cadre d’un partenariat Hubert
Curien avec l’Université de Nimègue, donnant ainsi à la notion de
décentrement tout son sens
(voir http://www.revue-relief.org/index.php/relief).
Pendant cette période enfin, plusieurs thèses sur Proust et des auteurs
étrangers ont été soutenues à Nanterre, dont deux en co-tutelle avec l’Italie
(Ilena Antici, sur Proust, Montale et Salinas, Elisabetta Abignente, sur Proust,
Mann et Garcia Marquez, Sandra Cheilan, sur Proust, Woolf et Pessoa) : on n’en
a pas fini avec les lectures comparatistes de Proust. Voir aussi
Périphérie,
Traduction.
Psychanalyse.
Les liens sont étroits entre l’interprétation
psychanalytique et l’herméneutique littéraire, comme en témoignent les
nombreuses références de Freud et de Lacan à la littérature. L’analyse
des rêves, lesquels obéissent aux lois de la métaphore et de la
métonymie, constitue une véritable poétique de l’inconscient. Les
scénarios fantasmatiques s’élaborent sur « une autre scène » qui
possède ses règles et sa dramaturgie. Le compte rendu d’une
psychanalyse s’apparente à une nouvelle d’Edgar Poe ou à une enquête
policière. Il est normal qu’en retour l’analyse littéraire, se
développant dans le champ des sciences humaines, emprunte à la
psychanalyse sa méthode et ses concepts, sans avoir pour autant la
prétention de psychanalyser les auteurs ni les textes. La littérature
comparée, qui met au jour des invariants et des typologies de
l’imaginaire, qui étudie les mythes et les genres, qui se consacre aux
transferts culturels et aux représentations de l’autre, trouve dans la
psychanalyse un apport théorique et critique essentiel. Certains
ouvrages de Camille Dumoulié en donnent l’exemple : Cet obscur objet
du désir. Essai sur les amours fantastiques, L’Harmattan, 1995 ;
Fureurs. De la fureur du sujet aux fureurs de l’histoire,
Anthropos-Economica, 2012. Mais cette approche intéresse aussi bien la recherche
collective que celle des doctorants (voir Désir).
|