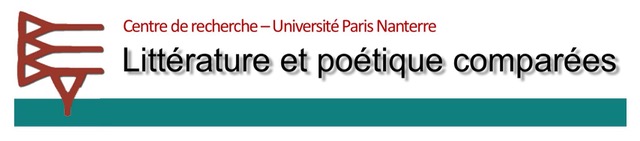O comme
Occident.
L’Occident ne se confond pas avec le territoire européen ;
il désigne aussi une frontière indécise, l'horizon mouvant du soleil
couchant, le « pays du soir ». C’est cette rencontre, dans le roman
moderne, entre une représentation géopolitique et un archétype
imaginaire qu’étudie l’essai de Philippe Zard, La Fiction de
l’Occident. Une communauté de questionnements sur la condition
occidentale nourrit les œuvres de Th. Mann, de F. Kafka et d’A. Cohen,
trois auteurs européens qui, tout à la fois, sont et ne sont pas
« d’Occident ». Les trois œuvres explorent l’Occident dans son
ambivalence (mythe d'autochtonie ou dynamique de déracinement, mythe
du déclin ou utopie du progrès, mythe du sens ou idéologie de la
puissance) à travers les itinéraires problématiques d’embusqués de
l'existence, d’adolescents ingénus, d’imprécateurs amoureux, de juifs
en errance ou d’arpenteurs sans mandat. C’est en continuité avec ce
premier essai que Philippe Zard explore d’une part les représentations
fictionnelles de la Révolution française et d’autre part les avatars
classiques et modernes de la figure juive dans les lettres.
Opéra.
Les études sur l’opéra constituent une spécificité nanterroise
depuis Françoise Ferrand, qui fut à l’initiative d’un séminaire repris
par Jean-Yves Masson puis par Emmanuel Reibel. Elles se déclinent à la
fois sur le plan pédagogique, grâce à des partenariats institutionnels
dont bénéficient les étudiants de master (Opéra de Paris, mais aussi
Théâtre du Châtelet, Opéra-Comique ou Théâtre de l’Athénée) et sur le
plan de la recherche, puisque le genre de l’opéra est un lieu idéal
pour penser tant les intermédialités artistiques que les questions de
réception, de diffusion et de popularisation de la littérature.
Plusieurs journées d’étude se sont succédé, consacrées à La donna del
lago de Rossini au cœur du romantisme européen, en partenariat avec
l’Opéra de Paris (2010), ou encore à Opéra et Cinéma aujourd’hui
(2013) en partenariat avec les Universités de Besançon et de Rennes.
Deux thèses sont en cours sur la question des écrivains-librettistes
dans la période post-wagnérienne et sur celle du mythe d’Héro et
Léandre dans l’opéra baroque.
Orient.
L’Orient, construction imaginaire des Occidentaux et point
mobile de désorientations culturelles multiples dans l’histoire de la
littérature, est un vaste objet d’études pour les comparatistes de
Nanterre, et l’occasion de collaborations fructueuses avec les
francisants. L’histoire de la fascination européenne pour l’Orient, et
la déconstruction de cette notion à l’aide de l’histoire, de
l’anthropologie et des études culturelles caractérisent notre
approche. La tradition du voyage en Orient depuis l’époque médiévale a
été étudiée par Marie-Christine Gomez-Géraud et Jean-Claude Laborie,
et la francophonie orientale et les questions coloniales et
postcoloniales ont été abordées par Jean-Marc Moura et Carole Boidin.
L’Orient imprègne nos travaux, du Proche-Orient arabe, qui est au cœur
de la recherche menée par Carole Boidin, à l’Extrême-Orient dont les
pratiques lettrées et les traditions théâtrales ont donné lieu à des
recherches de la part de William Marx, en passant par les terres
bibliques explorées par Sylvie Parizet. Il est également représenté
dans bon nombre d’enseignements tels que ceux qui concernent les
écritures du mythe, l’influence de la Bible ou les relations
interculturelles.