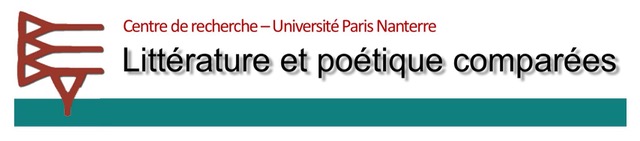|
Abécédaire des comparatistes de Paris Ouest Nanterre
M comme
Mille et une nuits.
Histoire curieuse d’une jeune femme qui,
connaissant les livres du monde entier, sut utiliser son savoir pour
mettre fin à une violence aveugle et obscurantiste. Allégorie possible
du comparatisme nanterrois (et objet de mille et un cours et travaux
tenant en haleine un public avide de sensations fortes). Carole Boidin
a consacré sa thèse à une comparaison entre ce recueil et l’histoire
antique d’un âne avide d’histoires à sensations, autre allégorie du
comparatisme. Outre cette thèse, Carole Boidin a publié des articles
dans plusieurs ouvrages collectifs consacrés aux Mille et une nuits et
organisera en 2015 un colloque international consacré aux rapports
entretenus par la théorie littéraire à ce recueil.
Musique.
Bien représentée à Nanterre, l’étude des liens entre musique
et littérature s’inscrit dans le sillage d’un comparatisme explorant
les espaces d’intermédialités artistiques, autant que linguistiques ou
culturelles. Un séminaire de recherche « musique et littérature :
perspectives méthodologiques et voies de la recherche », organisé par
Emmanuel Reibel en partenariat avec Béatrice Didier et l’Ecole Normale
Supérieure, constitue depuis 2005 un observatoire de ce champ de
recherche, dont certains travaux sont mis en ligne dans la revue
Silène. De nombreux colloques et publications ont vu le jour : Faust
ou la mélancolie du savoir (Desjonquères, 2003, dir. Jean-Yves
Masson) ; Fascinations musicales. Musique, littérature et philosophie
(Desjonquères, 2006, dir. Camille Dumoulié) ; Le Dictionnaire de
musique de Rousseau et sa descendance européenne (Vrin, 2014, dir.
Emmanuel Reibel). Des « rencontres musicales et littéraires » ont
également été instituées à l’Université Paris Ouest en 2009 (actes
publiés sur Fabula) et reprises tous les deux ans en partenariat avec
d’autres universités. Dans le sillage de la thèse de Guillaume Bordry
(« La musique est un texte » : histoire, typologie, et fonctions de la
description littéraire de la musique, en particulier dans l’œuvre
d’Hector Berlioz ») et de celle d’Emmanuel Reibel (L’Ecriture de la
critique musicale au temps de Berlioz), plusieurs travaux ont porté
sur la question des discours sur la musique, à l’image de la journée
d’étude co-organisée par Guillaume Bordry sur la thématique « Musique,
presse et littérature au XIXe siècle ».
Mythe.
Il n’est pas exagéré de dire que le mythe, ce « rien qui est
tout », selon Pessoa (« O mytho é o nada que é tudo »), a occupé et
continue d’occuper tous les comparatistes de Nanterre : dès la
première année de licence, les étudiants travaillent sur les mythes
littéraires, qui font l’objet de multiples cours et séminaires tout au
long du cursus de Lettres, et la mythocritique est par ailleurs l’un
des champs de recherche que la Littérature comparée ne cesse de
croiser (pour reprendre une expression de Pierre Brunel, le
comparatiste « ne sort guère de cette demeure grandiose » qu’est le
mythe). Livres, travaux et colloques se sont donc succédé à Nanterre,
depuis Le mythe d’Œdipe (Colette Astier, A. Colin, 1974) jusqu’au
récent séminaire de William Marx sur l’Histoire du mythe et de l’idée
de littérature, « Mythographie du lettré » (2009-2012), en passant par
les ouvrages de Véronique Gély, à qui l’on doit la création de
l’équipe « Mythopoétique », et ceux de Camille Dumoulié, qui a dirigé,
entre autres, Le Mythe en littérature. Mélanges offerts à Pierre
Brunel (PUF, 1999, en collaboration avec Yves Chevrel). Si nombreuses
sont les publications nanterroises sur le mythe qu’il est impossible
de les citer de façon exhaustive. Aux côtés des colloques et travaux
qui visent à explorer les réécritures de tel ou tel mythe littéraire
(pour ne citer que le seul XXIe siècle :
Dédale et Icare, de Michèle
Dancourt, CNRS éditions, 2002 ; Faust ou la mélancolie du savoir,
Jean-Yves. Masson dir., Desjonquères, 2003 ; L’invention d’un mythe :
Psyché 2006 ; Ganymède ou l’échanson, 2008 ;
Prénom : Médée, de
Michèle Dancourt et Emmanuel Reibel, éd. Des femmes, 2010 ;
Le Défi de Babel, 2001 et Babel, ordre ou chaos ?, 2010),
figurent des travaux qui font intervenir un « troisième terme » dont les enjeux sont
réexaminés à la lumière de la mythocritique : « mythe, littérature et
désir » (Don Juan ou l’héroïsme du désir, de Camille Dumoulié, PUF,
1993 ; Le Désir, Littérales, n° 24, Camille Dumoulié dir., Université
de Paris X-Nanterre, 1999) ; « mythe, littérature et
musique » (Faust : la musique au défi du mythe, d’Emmanuel Reibel,
Fayard, 2008) ; « mythe, Bible et littérature », ou encore « mythe,
littérature et politique » (colloque en 2006 : Lectures politiques des
mythes littéraires, Sylvie Parizet dir., Presses de Paris Ouest,
2009 ; séminaire de recherche dirigé par Véronique Gély, en
collaboration avec Anne Tomiche et le centre de recherche de Paris
13 : Modernités antiques, Presses de Paris Ouest, 2013). Mais parce
que le mythe, ce « poisson soluble dans les eaux de la mythologie »
(M. Détienne) est sujet à caution, d’autres travaux enfin examinent
les différentes approches critiques de cette « forme introuvable » :
Eléments de Littérature comparée. II. Thèmes et mythes, Claude de
Grève, Hachette, 1995 ; nombreux articles de Véronique Gély ;
Mythe et littérature, troisième numéro de
Poétiques comparatistes, Sylvie Parizet dir., Lucie éditions, 2008.
On aimerait clore ici cette (trop brève, et lacunaire) énumération de façon plus poétique, avec
Valéry : « Les mythes sont les âmes de nos actions et de nos amours »…
Voir aussi Antiquité,
Babel,
Baroque,
Désir,
Bible,
Ganymède,
Musique,
Politique.
|