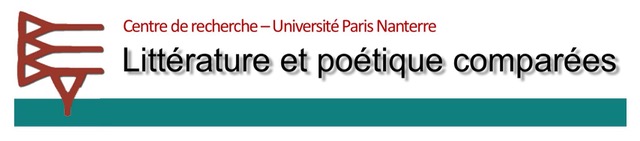|
Abécédaire des comparatistes de Paris Ouest Nanterre
L comme
Langues.
Anglais, Arabe, Allemand, Espagnol, Grec, Hébreu, Italien,
Japonais, Latin, Portugais, Russe, Turc.
Latinité.
Alors que l’idée de latinité a pu correspondre à une
idéologie identitaire ainsi qu’à une vision impérialiste et
colonialiste, un retournement semble s’opérer au XXe siècle. Dans un
monde globalisé, dominé par les valeurs du capitalisme et par la
culture anglo-saxonne, l’espace latin ne constituerait-il pas un lieu
alternatif qui traverserait les grands ensembles continentaux ainsi
que l’opposition Nord-Sud ? Cet espace géographique forme un ensemble
linguistique et culturel commun à quelques pays d’Europe, à l’Amérique
latine, au Canada, à un certain nombre de pays africains et à une
partie de la Caraïbe. En son sein, les anciennes revendications
identitaires, par la force des évolutions historiques et des réalités
sociales, ont fait place à des processus de métissage, à des formes
d’hybridation et à des productions culturelles novatrices. Dès lors,
la question de la latinité représente un enjeu comparatiste majeur où
se croisent l’histoire, la philosophie, la littérature, le droit, la
musique, la danse, la mode ou les pratiques culinaires. Le Centre de
recherches en Littérature comparée, dans le cadre du pôle « Tout-
Monde » de Paris Ouest, de 2009 à 2013, a été porteur d’un projet
consacré à la latinité aujourd’hui qui a conduit à se demander si
« l’esprit latin souffle encore sur la pensée »
(http://www.revue-silene.com/f/index.php?sp=colloque&colloque_id=11), à envisager la notion de la latinité à travers les lettres francophones,
hispanophones et lusophones (http://www.revue-silene.com/f/index.php?sp=colloque&colloque_id=9), ou encore à
s’interroger sur l’existence d’un « Eros latin » (colloque organisé à
Procida en collaboration avec l’Orientale de Naples, dont les actes
sont à paraître).
Lettrés.
La vie des lettrés témoigne, depuis l’apparition de
l’écriture il y a quelques milliers d’années, d’un rapport aux textes
préexistant à celui que nous disons aujourd’hui littéraire sans
coïncider forcément avec lui (voir Archéologie du littéraire). En
Égypte, en Chine, au Japon, en Grèce, à Rome, dans le Moyen Âge
européen, à la Renaissance comme dans la période la plus moderne, les
scribes, grammairiens, humanistes, philologues, professeurs et autres
antiquaires consacrèrent leur vie à transmettre des textes, à les
copier, les commenter, les traduire et à écrire à leur tour d’autres
textes dans un circuit de production textuelle généralisée. Bien des
discours (pratiques, moraux, médicaux, philosophiques, etc.) prirent
ces lettrés pour objets, bien des mythes se diffusèrent à leur sujet,
comme si les cultures écrites devaient nécessairement donner une place
particulière à ces passeurs privilégiés de l’écriture. À mi-chemin de
l’archéologie du littéraire et de l’étude des mythes, les lettrés ont
fait l’objet d’un livre par William Marx, intitulé Vie du lettré
(Éditions de Minuit, 2009), ainsi que d’un séminaire de recherche sur
la mythographie des lettrés où, de 2009 à 2012, passèrent des invités
tels qu’Antoine Compagnon, Laurent Nunez, Benoît Peeters ou Jean-
Benoît Puech. La thèse d’Andrei Minzetanu portait sur les pratiques
lettrées des écrivains et le rôle des citations dans leurs carnets de notes.
Littérature et Poétique comparées (Centre de recherches).
Le Centre de
recherches en Littérature et Poétique comparées est une Équipe
d’Accueil créée par Camille Dumoulié en janvier 2005.
Il est composé
de trois équipes :
« Littérature & Idée », dirigée par Camille
Dumoulié ;
« Mythopoétique », dirigée par William Marx et Sylvie
Parizet ;
« Poétique du récit », dirigée par Karen Haddad ».
Emmanuel Reibel coordonne le groupe de recherches « Littérature et
Musique ». Enfin, un axe commun avec le centre des Sciences de la
Littérature Française a été créé :
« Espaces littéraires
transculturels », auquel collaborent Jean-Claude Laborie et Jean-Marc
Moura. Au-delà de leurs spécificités, les équipes se donnent un
objectif commun : étudier la diversité des littératures et de leurs
interactions en adoptant une approche théorique interdisciplinaire et
transculturelle. Suivant cette perspective, Littérature et Poétique
comparées contribuent à élaborer une esthétique de l’art littéraire
pour laquelle la question de la forme est intimement liée aux enjeux
existentiels et philosophiques, éthiques et politiques. « Poétique
comparée » s’entend aussi dans le sens de l’approche comparée de la
poésie, domaine de recherche original et exigeant dans le champ des
études littéraires. Colette Astier puis Jean-Yves Masson ont
successivement développé cette recherche à Paris Ouest et ont ouvert
la voie pour de jeunes chercheurs. En parallèle avec les colloques,
journées d’études et séminaires régulièrement proposés par les
enseignants-chercheurs, le Centre accueille un « séminaire des
doctorants », entièrement organisé par ces derniers, qui,
mensuellement, aborde des problématiques liées aux diverses thèses en
cours. Il reçoit aussi un nombre important de chercheurs étrangers
dans le cadre de stages doctoraux ou post-doctoraux. Enfin, une
collection homonyme des Presses Universitaires de Paris Ouest lui est
associée. Site du centre : http://www.litterature-poetique.com.
|