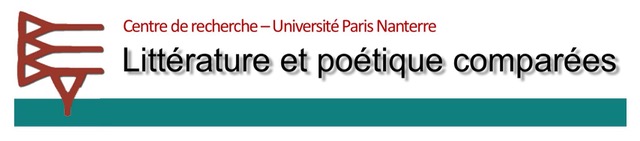|
Abécédaire des comparatistes de Paris Ouest Nanterre
K comme
Kadaré.
Les romans d’Ismail Kadaré, traduits depuis l’albanais, le
français et l’anglais dans une quarantaine de langues, ont construit
un univers où les mythes grecs et les légendes balkaniques rencontrent
le quotidien des régimes totalitaires de l’Union soviétique, des
Balkans ou de la Chine, dans le brouillard des rumeurs, des rêves, des
erreurs. Un colloque international, organisé en mai 2008 par Véronique
Gély, avec la collaboration d’Ariane Eissen, de Jean-Paul Champseix et
d’Ardian Marashi, a réuni pour la première fois des universitaires,
écrivains, journalistes albanais et des chercheurs français,
américains, australiens etc. pour explorer les Lectures d’Ismail
Kadaré (Presses Universitaires de Paris Ouest, 2011, éd. A. Eissen et
V. Gély) : celles dont la marque se retrouve dans l’œuvre, et celles
que cette œuvre inspire, souvent contradictoires, signes d’une
réception marquée par l’histoire et l’idéologie.
Kafka.
Kafka a inspiré et nourri, intimidé ou hanté écrivains,
peintres, compositeurs, cinéastes. L’œuvre a été méditée – jusqu’à
l’obsession –, célébrée – jusqu’à l’idolâtrie –, imitée – jusqu’au
maniérisme. Sa personne même est devenue un mythe littéraire, sujet de
biographies imaginaires. La modernité fait un usage immodéré de la
notion de “kafkaïen” pour caractériser ici un système politique, là
une crise identitaire, tantôt une impuissance à agir, tantôt une
incapacité à comprendre. Un colloque sur la postérité littéraire et
artistique de Kafka s’est tenu à Nanterre en mars 2004, dont les Actes
ont paru en 2007 sous le titre Sillage de Kafka (sous la dir. de
Philippe Zard), coll. « L’esprit des Lettres », éd. Le Manuscrit. Sur
Kafka et le politique, voir aussi F. Leichter-Flack, La Complication
de l’existence. Sur Kafka, Platonov et Céline, 2010.
|