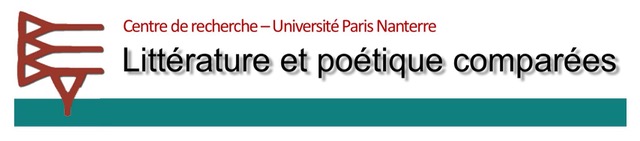|
Abécédaire des comparatistes de Paris Ouest Nanterre
E comme
Ethique.
Tout un champ de recherches a émergé, aux Etats-Unis
notamment ces trente dernières années, autour de l’idée que la
littérature pouvait et devait contribuer au questionnement permanent
des normes morales inhérent au fonctionnement de la démocratie
libérale, et plus généralement, au débat public sur les questions de
droit et de morale. La littérature peut être ainsi une véritable
« école de la réflexion morale » : non pas au sens où elle se
chargerait de transmettre un contenu normatif préexistant (des
« leçons de morale »), mais parce que la lecture des grands textes
littéraires nous fait traverser une expérience morale : refuge de la
complexité du monde, la fiction littéraire porte en elle une réserve
de sens, une gamme de nuances que le raisonnement théorique ne peut
atteindre. La démarche trouve une application « à la française » avec
les travaux et enseignements de Frédérique Leichter-Flack (Le
Laboratoire des cas de conscience, 2012) et de Philippe Zard
(« L’animal et l’homme », in La Métamorphose de Kafka, 2004).
Différents cours proposés à Nanterre sous la rubrique « Ethique et
littérature » parient ainsi sur la pertinence de la littérature pour
décrypter les enjeux d’éthique contemporains.
Etrangère (Œuvre).
Une des originalités de l’enseignement en
littérature comparée à Paris-Ouest est le module « Etude d’une œuvre
de langue étrangère ». Parallèlement à la méthode traditionnelle qui
confronte deux ou trois œuvres empruntées à différents domaines
linguistiques, on y apprend à aborder en profondeur un seul (grand)
texte sans céder sur l’exigence comparatiste : le texte « étranger » y
est étudié pour lui-même, mais aussi à travers ses traductions, ses
transpositions (musicales, plastiques, cinématographiques), sa
réception.
Europe.
Si la littérature européenne n’est pas, loin de là, la seule
étudiée à Nanterre (voir Brésil,
Orient,
Russes,
Périphérie), elle
figure dans nombre d’intitulés de séminaires ou de colloques. Depuis
2007, notre Centre est associé au groupe de recherche européen « Lire
en Europe Aujourd’hui », créé par Franc Schuerewegen (Universités
d’Anvers et de Nimègue), qui relie à présent une vingtaine
d’Universités, du Nord (Pays-Bas) au Sud (Espagne). Initiative
originale de chercheurs en littérature française et étrangère, LEA
rencontrait ainsi l’un des fondements de la littérature comparée, la
comparaison des lectures. A l’origine de nombreux colloques à
l’étranger auxquels s’est associé notre centre (Porto, Anvers,
Lisbonne, Cadix..), LEA a permis l’organisation par Karen Haddad, en
2010, de la première Université d’été du département de Lettres
modernes, sur le thème des études littéraires et de la globalisation,
qui a accueilli et logé sur le campus de nombreux étudiants et
enseignants européens. Au fil des années, plusieurs doctorants ou
étudiants de master de Nanterre se sont retrouvés et se retrouveront
encore dans les Universités d’été organisées sous l’égide de LEA.
Ecriture de soi.
Si les travaux de Philippe Lejeune sur l’autobiographie ont commencé à
Nanterre, dans une perspective limitée à la littérature française,
l’approche comparatiste, en passant les frontières, permet aussi de
réfléchir à celles qui séparent les genres. Les distinctions entre
autobiographie, autofiction, écriture de soi ou fiction de façon
générale sont moins pertinentes dès qu’on les met à l’épreuve de
traditions littéraires et de corpus différents. C’était le pari de
Karen Haddad dans L’Enfant qui a failli se taire. Essai sur l’écriture
autobiographique (Champion, 2005), et c’est un travail qui se poursuit
à Nanterre à travers séminaires et thèses soutenues ou en cours
(Aurélie Moioli, 2013). Un colloque sur « Les lieux de l’écriture de
soi » aura lieu en 2015.
|