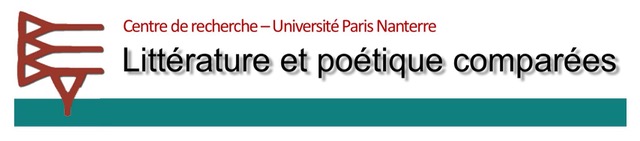|
Abécédaire des comparatistes de Paris Ouest Nanterre
D comme
Désir.
Si, selon René Char, « le poème est l’amour réalisé du désir
demeuré désir », la poétique devrait être la science ou la discipline
du désir. De nos jours, plus que jamais, il paraît improbable de faire
des études de Lettres sans un « désir fou », et la moindre des
exigences qu’on devrait avoir à l’égard des étudiants de littérature
est qu’ils cultivent leur désir. Ainsi, les idées prendront chair,
l’arbre de la théorie reverdira et passer des examens ne sera pas le
seul but d’une année universitaire. On trouverait, au bout du compte,
un peu de sens, et même de « jouis-sens ». Mais comment l’éviter ? Le
désir se loge au cœur des notions évoquées dans cet abécédaire
comparatiste : littérature, philosophie, psychanalyse, mythes,
latinité (éros latin), et les réunit toutes (ainsi qu’a tenté de le
faire Camille Dumoulié dans Le désir, Armand Colin, 1999). Une
création artistique, par le rapport qui s’instaure entre le spectateur
et l’œuvre ou entre le lecteur et le texte, n’est-elle pas, pour
reprendre ce qui fut le titre d’un séminaire de recherches qui s’est
déroulé de 2004 à 2006, un « dispositif désirant » ? Et que racontent
les grands mythes modernes, sinon des configurations nouvelles du
désir, telles qu’elles peuvent apparaître chez Faust (voir le recueil
collectif dirigé par Jean-Yves Masson : Faust ou la mélancolie de
savoir, Desjonquères, 2003) ou chez Don Juan (voir Camille Dumoulié,
Don Juan ou l’héroïsme du désir, PUF, 1993, et le Dictionnaire de Don
Juan (dir. Pierre Brunel) auquel ont contribué nombre de chercheurs
comparatistes de Paris Ouest.
Dostoïevski.
Les livres de Karen Haddad (L’illusion qui nous frappe,
Champion, sur Dostoïevski et Proust, 1994), Colette Astier (sous le
nom de Gabrielle Althen, Dostoïevski, le meurtre et l’espérance, Cerf,
2006), Frédérique Leichter-Flack (Le Laboratoire des cas de
conscience, 2012), une thèse soutenue (Sarah Boudant, sur Dostoïevski
et Hugo, 2012), une autre en cours (Nicolas Aude) en témoignent :
Dostoïevski, si longtemps figure de référence pour la littérature et
la philosophie européennes, garde une place centrale parmi les Russes
de Nanterre. Une journée d’études lui a été consacrée en 2008, autour
de son traducteur André Markowicz. Son œuvre, à travers les travaux,
séminaires et cours des comparatistes, est inlassablement reprise,
tant du point de vue éthique que poétique. Voir aussi Dissidence,
Ethique, Révolution,
Russes.
Dissidence.
Comment la littérature dégage-t-elle, parfois sans même y
songer, des espaces de dissonance, de subversion, d’émancipation, de
liberté ? Où, quand, comment, commence la dissidence dans la
littérature ? Par les prises de conscience précoces qu’elle traduit et
permet, la littérature a-t-elle ouvert la voie à la défense des droits
de l’homme ? C’est sur toute la gamme des formes de résistance
opposées au pouvoir par la littérature, dans le contexte de l’URSS,
qu’un colloque s’est penché en 2008, dont un numéro spécial de la
revue Silène a rendu compte en 2010 (Une dissidence intérieure ? La
littérature soviétique en résistance, sous la direction de Frédérique
Leichter-Flack).
|