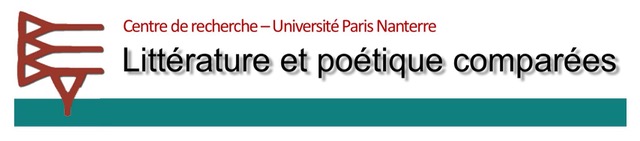|
Abécédaire des comparatistes de Paris Ouest Nanterre
B comme
Babel.
Dans l’imaginaire collectif, l’épisode de Babel a longtemps été
associé à des termes comme « orgueil, ruine et confusion », pour
reprendre la triade affichée par Roger Caillois en couverture de son
livre. Mais c’est l’autre face de ce mythe biblique, la « Babel
heureuse » évoquée par Barthes, qui intéresse les comparatistes de
Nanterre, comme en témoignent les travaux issus d’un colloque organisé
en mars 2000 (Le Défi de Babel. Un mythe pour le XXIe siècle,
Desjonquères, 2001, recueil auquel ont notamment contribué Camille
Dumoulié, Jean-Yves Masson et Philippe Zard), ou encore l’essai de
Sylvie Parizet (Babel : ordre ou chaos ?, Ellug, 2010). Voir dans la
diversité des langues et des cultures une inestimable richesse, et
consacrer la « bénédiction de Babel », n’est-ce pas là l’essence même
du comparatisme ? Voir aussi Bible,
Mythe.
Baroque.
La tenue d’un colloque en mars 2011 « Vanités d’hier et
d’aujourd’hui, ou la permanence de l’éphémère », publié par Jean-
claude Laborie en deux parties dans les revues électroniques Épistémé
(Paris 3) et Textimage (Lyon 3) a permis de réintégrer le corpus
baroque aux activités d’un centre qui a toujours développé les
croisements entre les arts, après le séminaire de recherche sur les
« mythes de l’Europe renaissante et baroque » animé par Véronique Gély
entre 2005 et 2008 (voir dans Silène les articles de Didier Souiller,
Jean Canavaggio, Alexis Tadié, Zoé Schweitzer, François Laroque,
Paule Desmoulière) et la publication, en 2006 de son livre L’invention
d’un mythe : Psyché. Allégorie et fiction, du siècle de Platon au
temps de La Fontaine (H. Champion) ; voir aussi Ganymède.
Bible.
L’étude de la Bible envisagée d’un point vue littéraire, si
prisée des Anglo-saxons, a tardé à s’imposer en France (les ouvrages
d’Alter ont mis plus de vingt ans à être traduits dans notre
langue !)… sauf à Nanterre : dans les années quatre-vingt, déjà, les
étudiants de licence pouvaient suivre un tel cours, qui fait désormais
partie intégrante du cursus des études de Lettres, et de nombreux
travaux et séminaires ont été et sont toujours consacrés au « Livre
des livres », selon des approches critiques très variées. Aux confins
de la philosophie, de l’exégèse et de la littérature, tout d’abord,
dans le domaine de l’herméneutique (Paul Ricoeur a été Doyen de la
Faculté de Nanterre) : on peut évoquer ici les travaux d’Anne-Marie
Pelletier (D’âge en âge les Ecritures. La Bible et l’herméneutique
contemporaine, Lessius, 2004), ou le colloque « Herméneutique biblique
et création littéraire » qui s’est tenu en 2006 à Nanterre (Les
écrivains face à la Bible : herméneutique et création, Le Cerf, 2011,
dir. Jean-Yves Masson et Sylvie Parizet). Mais aussi dans le domaine
de la « poétique du récit » : on songe au colloque sur « Le Livre et
le roman » organisé en 2011 par Karen Haddad, Elise Duclos et Sandra
Cheilan (Livre et roman aux XX et XXe siècles, actes parus dans la
revue Silène). Ou encore dans celui de la mythocritique (fort
logiquement, puisqu’il s’agit là d’une autre spécialité nanterroise,
voir « Mythe ») : Figures bibliques, figures mythiques (dir. Cécile
Hussherr et Emmanuel Reibel, ed. rue d’Ulm, 2002), travaux sur le
mythe d’Isaac (journée d’étude en 2010, publiée dans Silène) ou sur
Babel. Mais les études sur la Bible s’inscrivent aussi, de façon
novatrice, au carrefour d’un autre champs de recherche, les études
postcoloniales : séminaire sur le lien paradoxal que la littérature
des anciens pays colonisés entretient avec la Bible, travaux de
doctorants et jeunes chercheurs (Chloé Angué achève une thèse sur
« L’imaginaire biblique dans la littérature du Pacifique »). Un
dernier chantier, enfin, auquel participent de nombreux nanterrois,
tente d’offrir une synthèse des travaux suscités par le champ de
recherche « Bible et Littérature », un Dictionnaire encyclopédique de
la Bible dans la littérature mondiale (à paraître aux éditions du Cerf
sous la direction de Sylvie Parizet).
Brésil.
L’étude des liens culturels et littéraires qui unissent la
France et le Brésil constitue un axe de recherches comparatistes
original, développé de longue date à Paris Ouest. Il a été inauguré
par Pierre Rivas, actuellement maître de conférences honoraire, puis
repris par Michel Riaudel, alors ATER, qui a soutenu en 2007 une thèse
intitulée Intertextualité et Transferts (Brésil, Etats-Unis, Europe) :
Réécritures de la Modernité Poétique dans l’œuvre d’Ana Cristina
Cesar, sous la direction de Colette Astier, et qui poursuit un travail
de passeur culturel entre la France et le Brésil par ses nombreuses
traductions, publications et directions d’ouvrage. A l’occasion de
l’année du Brésil en France, avec Pierre Rivas, il a codirigé un grand
nombre d’ouvrages et de numéros de revues consacrés à la littérature
brésilienne. Cette même année, le centre de recherches en Littérature
et Poétique comparées a organisé Les Journées brésiliennes de Nanterre
qui, pendant près d’un mois, ont donné lieu à une série de
manifestations dédiées à tous les aspects de la culture brésilienne :
littérature, cinéma, danse, musique, capoeira, art culinaire, etc. De
2006 à 2008, le centre a été partie prenante du programme de
coopération universitaire entre la France, le Brésil et le Chili,
ARCUS 7 – Île de France (Actions en Régions de Coopération
Universitaire et scientifique). Dans ce cadre, Camille Dumoulié a
dirigé le projet « Croisement d’écritures-France/Brésil/Chili » qui a
été l’occasion de nombreux échanges et collaborations avec les
universités brésiliennes (São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal,
Recife, Salvador de Bahia, Porto Alegre, etc.). Parmi les publications
liées à ces manifestations, on peut citer le recueil collectif
codirigé par C. Dumoulié et M. Riaudel : Le corps et ses traductions,
Desjonquères, 2008, publié en portugais dans Silène : O Corpo e suas
traduções (http://www.revue-
silene.com/f/index.php?sp=colloque&colloque_id=8). Depuis lors, le
centre de recherches organise régulièrement des colloques,
manifestations ou publications conjointes avec des universités
brésiliennes, ainsi, en 2013, le colloque Les Maudits sous les
Tropiques, qui s’est tenu pour une part à l’Université de São Paulo
et, pour autre part, à Paris Ouest. Ces dernières années, cet axe a
été renforcé par la présence et l’activité de Jean-Claude Laborie dont
les travaux portent sur la mission jésuite au Brésil (Mangeurs d’homme
et mangeurs d’âme, une correspondance missionnaire au XVIe, la lettre
jésuite du Brésil, 1549-1568, Honoré Champion, 2003), la littérature
de voyage et l’étude des transferts culturels France-Brésil. A ce
titre, il a dirigé l’ouvrage collectif : Excessives Amériques.
Héritage et transfert culturel (Desjonquères, 2011). Enfin, le nombre
croissant de thèses comparatistes portant sur le domaine brésilien,
ainsi que celui des échanges entre professeurs et étudiants des deux
pays, dans le cadre du centre de recherches, attestent la vitalité de
cet axe.
|