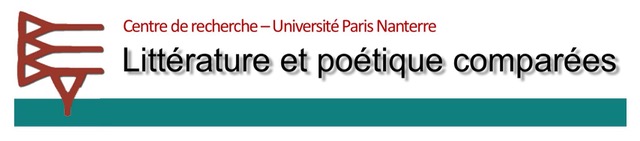|
Abécédaire des comparatistes de Paris Ouest Nanterre
A comme
Abécédaire.
Cet abécédaire a été rédigé à l’occasion de la publication
du livre collectif Nanterre en toutes lettres. Les cinquante ans du
département de littératures française et comparée, paru en 2014 aux
Presses Universitaires de Paris Ouest, sous la direction de Pierre
Hyppolite et Guillaume Peureux (ISBN : 978-2-84016-187-5), dans le
cadre de la célébration des 50 ans de l’Université de Nanterre. Il est
le fruit de la contribution des enseignants-chercheurs qui sont
membres du centre « Littérature et Poétique comparées », depuis la
date indiquée entre parenthèses, ou qui l’ont été : Carole Boidin
(2011), Camille Dumoulié (1996), Véronique Gély (2004-2008), Karen
Haddad (2005), Frédérique Leichter-Flack (2004), Jean-Claude Laborie
(2010), William Marx (2009), Jean-Yves Masson (1998-2005), Sylvie
Parizet (1998), Emmanuel Reibel (2003), Philippe Zard (2000).
Antiquité.
L’Antiquité gréco-romaine fait partie intégrante des
domaines d’exploration du Centre de recherches en Littérature et
Poétique comparées. Les liens entre mythe et littérature, en
particulier, rassemblent de longue date une vaste équipe du Centre,
dont la revue électronique porte le nom de Silène, divinité grecque de
l’inspiration joyeuse. Des études plus précises ont été menées sur
différents héritages supposés de l’Antiquité, montrant les ambiguïtés
de cette généalogie. William Marx a publié en 2012 une étude intitulée
Le Tombeau d’Œdipe. Pour une tragédie sans tragique
(Éditions de Minuit) qui retrace la façon dont les pratiques occidentales de la
tragédie se sont définies par référence à la tragédie grecque tout en
déformant notre perception de cette dramaturgie ancienne, qu’il évoque
au moyen de travaux d’antiquisants et de comparaisons avec d’autres
dramaturgies du monde. Carole Boidin a étudié les réceptions
européennes du roman antique en les comparant à celles de certaines
traditions narratives arabes, pour mieux interroger, en retour, les
pratiques de la fiction et du récit dans l’Antiquité et la culture
arabo-musulmane de l’époque classique. Ces comparaisons montrent la
relativité de la notion même d’Antiquité, tout en mettant en valeur la
productivité intellectuelle et artistique qu’elle a pu manifester. A
chacun son Antiquité, telle semble être la meilleure façon de définir
notre approche, qui invite également aux rapprochements et au partage
de cet héritage multiforme et véritablement « silénien ».
Archéologie du littéraire.
L’appellation de littérature n’a guère plus
de deux siècles à son actif. Le terme s’imposa vers l’époque
romantique pour désigner ce qu’on nommait autrefois poésie ou belles-
lettres – ou qui n’avait peut-être même pas de nom : on composait des
fables, des contes, des épopées, des comédies, des mémoires, toutes
sortes de choses, mais on ne faisait pas de littérature. Il y a donc
fort à parier que les qualités attribuées généralement à la
littérature en tant que telle (universalité, impersonnalité,
littérarité, autonomie, etc.) ne sont pas plus anciennes que le nom
lui-même, même si l’on a souvent tendance à vouloir retrouver ces
qualités dans des œuvres bien antérieures à l’époque romantique ou
dans des cultures totalement étrangères à la tradition européenne.
Faire l’archéologie du littéraire, c’est précisément vouloir échapper
à cette dictature du mot littérature, en replaçant les œuvres
anciennes ou lointaines dans un écart épistémologique indispensable à
leur appréhension correcte. C’est aussi examiner l’évolution même du
statut et de la fonction de la littérature à l’époque moderne. Il
s’agit en fin de compte de faire l’histoire différentielle de ce qu’on
nomme aujourd’hui littérature, mais qui ne l’a pas toujours été.
L’entreprise, éminemment comparatiste (car il y a un comparatisme dans
le temps comme dans l’espace), concerne l’Antiquité (voir ce mot,
ainsi que Tragédie) mais pas seulement. On retrouve l’archéologie du
littéraire et l’histoire de l’idée de littérature dans les recherches
de Carole Boidin sur la culture arabo-musulmane de l’époque classique
comme dans la thèse de William Marx sur l’invention de la critique
formaliste au xxe siècle (Artois Presses Université, 2002), dans ses
enquêtes sur les lettrés (voir Lettrés) ou dans L’Adieu à la
littérature : histoire d’une dévalorisation (xviiie-xxe siècle)
(Éditions de Minuit, 2005). Ces travaux donnent l’occasion de
collaborations fructueuses avec d’anciens membres ou des
correspondants du Centre comme Véronique Gély (université Paris-
Sorbonne), Ute Heidmann (université de Lausanne) et Florence Dupont
(université Paris Diderot).
Artaud.
Antonin Artaud n’est pas que l’auteur du Théâtre et son
Double, comme on le croit parfois, oubliant les 26 tomes qui composent
ses Œuvres complètes. Ecrivain, poète, mythographe, ésotériste,
dessinateur, acteur, metteur en scène, scénariste et tragédien,
mystique et matérialiste intégral, sublime et abject, fou et
extralucide, pathétique et grotesque, clown et nouveau messie,
philosophe et imprécateur, le pauvre Antonin Artaud, qui se voulait
intouchable et incomparable, a offert bien malgré lui une pitance de
choix aux comparatistes. D’autant que, tout au long du XXe siècle, il
a entraîné dans son sillage nombre de philosophes, d’acteurs, de
peintres et de poètes qui sont devenus presque indissociables de son
nom. S’il est dérisoire de vouloir donner à une discipline
universitaire une prééminence dans l’approche d’un tel auteur, il faut
néanmoins reconnaître l’intérêt des études spécifiquement
comparatistes de son œuvre, telles qu’elles ont pu être menées par
certains chercheurs de Paris Ouest, aussi bien à la faveur de leur
thèse de doctorat, comme celle de Jonathan Pollock, publiée sous le
titre Le Rire du Mômo. Antonin Artaud et la littérature anglo-
américaine (Kimé, 2002), ou celle de Gérald Garutti (en cours) sur la
dramaturgie de la Révolution chez Brecht et Artaud, qu’à la faveur
d’une recherche personnelle suivie (ainsi les ouvrages de Camille
Dumoulié : Nietzsche et Artaud, PUF, 1992 ; Antonin Artaud, Le Seuil,
1996 ; Artaud, la vie, Desjonquères, 2003), ou à l’occasion d’un
colloque international à l’instar de celui qui s’est tenu à Nanterre
lors du cinquantième anniversaire de la mort d’Artaud (Les Théâtres de
la cruauté. Hommage à Antonin Artaud, Desjonquères, 2000). Au cœur des
avant-gardes théâtrales mondiales, l’œuvre d’Artaud suscite l’intérêt
de chercheurs qui, du Japon, de Corée, de Chine, des USA, d’Amérique
latine, engagent avec elle un dialogue des cultures, comme l’atteste
la thèse en cours de Sung Jin Park consacrée à L’étrangeté dans
l’œuvre d’Antonin Artaud. Un tel intérêt est indissociable de la
recherche sur le théâtre du XXe siècle. On peut citer en exemple la
thèse d’Arnaud Marie, Le Théâtre de Jean Genet, Pier Paolo Pasolini et
Federico Garcia Lorca : la cérémonie impossible. Frontières et marges
de la représentation, ou mentionner l’étude de l’œuvre de Carmelo
Bene, menée depuis longtemps au sein du centre Littérature et Poétique
comparées, qui a fait l’objet d’un grand colloque organisé en janvier
2013 par les laboratoires Scène et Savoirs (Paris 8) et HAR (Paris
Ouest) : D’après Carmelo Bene (actes parus
dans la Revue d’Histoire du Théâtre, n° 263, juillet-septembre 2014).
|